
Dans son dernier film, « Aya », Simon Coulibaly Gillard nous présente l’histoire d’une jeune fille vivant sur une île en perdition. Univers a eu l’occasion de participer à la séance-débat organisée ce samedi 23 avril au Plaza Art, à Mons, dans le cadre de l’Éco-festival demain.
« Aya grandit avec sa mère sur l’île de Lahou. Joyeuse et insouciante, elle aime cueillir des noix de coco et dormir sur le sable. Pourtant, son paradis est voué à disparaître sous les eaux. Alors que les vagues menacent sa maison, Aya fait un choix : la mer peut bien monter, elle ne quittera pas son île ».
Entre fiction et réalité, ce film / documentaire nous met face à une conséquence directe du dérèglement climatique : la destruction d’un lieu de vie.
Il s’agit ici de l’île de Lahou, au large de la Côte d’Ivoire. Un lieu entre mer et lagune, qui disparaît sous les assauts des vagues.
La mer avance sans jamais s’arrêter, tandis que les habitants enchaînent déménagement sur déménagement.
Mais jusqu’à quand ? À Lahou, même les habitants du cimetière doivent être déplacés.
Aya montre comment les crises écologiques impactent plus les pauvres et à fortiori les femmes. Celles-ci, de par leur condition, ont moins accès aux métiers gratifiants et donc bien payés. Précarisées, elles se retrouvent obligées à vivre dans des lieux à plus grand risque climatique. C’est ce que vivent Aya et sa mère.
Le terme « écoféminisme » a été apposé à ce récit. Lors du débat suite au film, Simon Coulibaly Gillard, le réalisateur / scénariste / caméraman / monteur / ingé son d’Aya, explique qu’il n’a pas essayé de dicter un code, un courant de pensée au travers ce film. Il est allé en Côte d’Ivoire, y a rencontré des personnes et a raconté un bout de leurs vies.
Aya et sa mère, deux femmes qui vivent sans mari, sans père, sont seules face au monde. Elles montrent dans leur histoire la destinée de femmes fortes qui luttent, seules, face aux éléments.
Vous êtes sûrement habitués à entendre les mots « écologie » et « féminisme » séparément. C’est peut-être même la première fois que vous entendez parler d’écoféminisme. Pour nous aussi, il y a quelques jours, ce terme était encore inconnu.
Nous n’aurons pas ici pour idée de vous donner une définition concise et précise de ce qu’est l’écoféminisme. Ces quelques lignes seront pour nous l’occasion de vous partager ce que nous avons pu en apprendre dernièrement.
Pour la partie théorique, l’écoféminisme est « un courant philosophique, éthique et politique, né de la conjonction des pensées féministes et écologistes ».
En 1972, le 1er Rapport Meadows (aka The Limits to Growth) est publié. Ce travail démontre le lien entre croissance économique et désastres écologiques. Le système capitaliste dans lequel nous vivions déjà à ce moment-là a des conséquences et elles ne sont pas belles à voir . En d’autres termes, la croissance absolue a un prix : celui de la destruction de la Terre.
Suite à ça, en France, en 1974, la femme de lettres Françoise d’Eaubonne est la première à parler d’écoféminisme. Elle théorise dans son livre Le féminisme ou la mort l’idée que le patriarcapitalisme fait deux victimes : les femmes et la planète.
L’oppression des femmes par les hommes serait donc liée à la destruction de la Terre par ces derniers. Du moins, elles suivraient les mêmes mécanismes.
Le 18 août dernier, la candidate écologiste française Sandrine Rousseau déclarait sur France Inter : « L’écoféminisme, c’est de dénoncer ce qui est au cœur de notre système, c’est-à-dire la prédation ».
Le malheur que subit Aya sur son île nous renvoie à la phrase « L’avenir sera écoféministe ou ne sera pas ». A l’heure où les mouvements féministes et écologistes sont de plus en plus visibles et audibles, une convergence des luttes semble nécessaire, et même vitale, à l’avenir de tous.
✍️ : Violette Larcin
🖌 : Siilen Dig

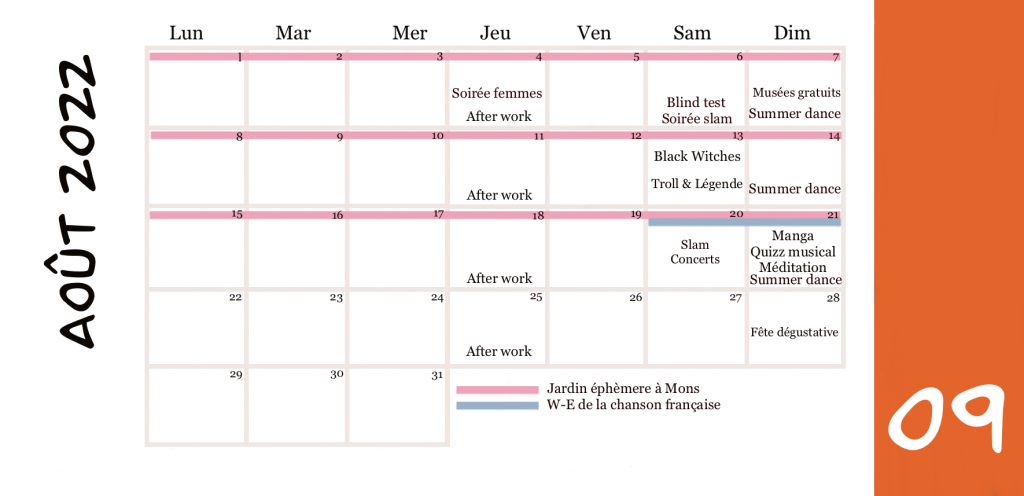
Les inégalités face au dérèglement climatique sont connues, reconnues, martelées, constatées. Qu’elles soient liées au genre, à l’origine géographique, au patrimoine des humains, plus personne ne pourrait le nier.
Les bases sont posées indiscutablement. Le film est magnifique, et l’article qui énonce le sujet ici est clair et documenté. Alors oui, l’écofeminisme semble être une lutte légitime et prometteuse.
Bravo, pour la force du film, et bravo pour la réflexion amorcée au travers de l’article !
Merci