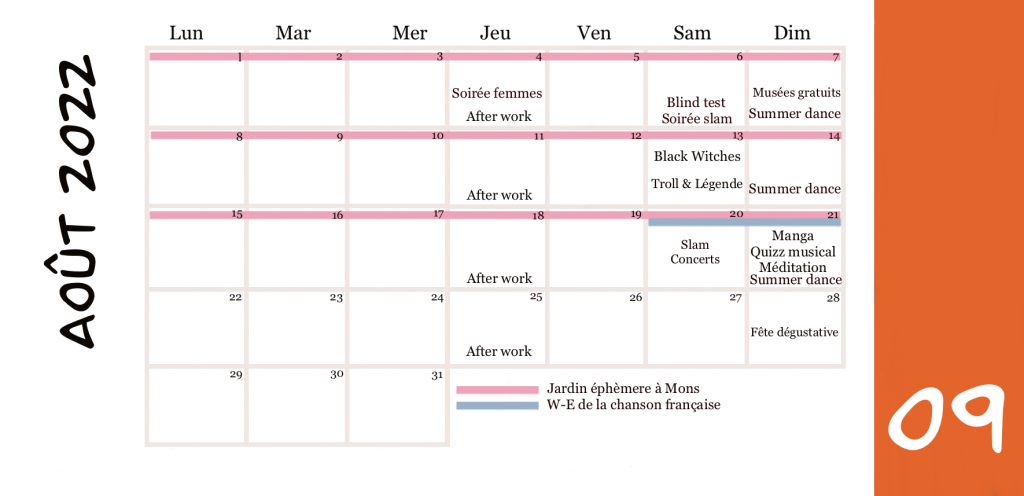Lundi 25 avril, Univers a participé à la journée de réflexion et d’exploration à Maison Folie (à Mons) dans le cadre du cycle « Habiter la ville », organisé par Mons art de la scène, UCLouvain FUCaM Mons, Fondation Mons 2025 et Technocité. La question autour de laquelle s’est articulée la journée : « Que mettre en place entre artistes, citoyen·nes et institutions pour créer du lien social durable sur le territoire ? »
Retraçons la journée ensemble :
8h30 : Accueil chaleureux autour d’un café dans la « Margin’halle ».
Un espace de rencontre coloré où se mêlent lieux de conversation, bar participatif, magasin gratuit. Ensuite petite introduction ; Mons étant la capitale européenne de la culture depuis 2015, comment cette culture pourrait-elle rassembler les citoyens durablement ? Les différentes interventions de la journée tentent d’y répondre.
9:00 : La culture créatrice de liens ?
Damien Vaneste, sociologue et maître de conférences à l’UCLille et l’UCLouvain, évoque au premier plan deux réserves sur l’association entre culture et lien social. La première suivant les idées de Pierre Bourdieu et en citant le film « Le goût des autres », il dit que les différentes cultures propres à certains groupes peuvent perdre ceux qui ne partagent pas les mêmes références. La deuxième sur la question de l’émancipation reprenant le livre d’Héloïse Lhérété, « Comment la littérature peut changer nos vies », qui explique que les livres peuvent entraîner des répercussions durables en permettant d’investir d’autres mondes que le sien. Il conclut avec ceci :
« Sans être une solution magique qui unifie le sien social, la culture n’est pas pour autant un arrière-plan social. Si la culture peut renforcer la séparation sociale comme déliter le lien social, elle peut aussi créer du lien social ou le vivifier. »
Pour M. Vaneste trois points sont à soulever sur les dynamiques artistiques, le territoire et la reconfiguration du lien social :
1. Partager un monde commun – Les productions culturelles comme support de sociabilité.
À travers l’exemple d’une radio tenue par des personnes porteuses de handicap
psychique, il démontre que la culture populaire telle que la musique permet de créer du lien entre ceux qui ne seraient pas destinés à en avoir.
2. Rendre visible un monde – (Ré)affirmer des existences passées et actuelles.
Il montre qu’à travers des démarches artistiques telles que le parcours « sur » Guérande réunit et rassemble grâce au rappel culturel et la visibilité qu’amène un projet artistique.
3. Fabriquer et éprouver une expérience sensible originale.
Damien Vaneste prend l’exemple de l’histoire touchante de l’initiative « C’est qui mon village ? ». Reprenant les témoignages d’habitants accueillants et d’artistes accueillis au cœur de village qui n’était pas les leurs. Les habitants ayant un sentiment de réunification à travers l’art participatif ou parfois la rencontre presque forcée qui finalement crée un lien nouveau. Les artistes, eux, poussés parfois à la déstabilisation, plongent au cœur d’une culture qu’ils ne maîtrisent pas, les amenant à la découverte de l’autre. N’importe qui peut donc prendre part la démarche et faire l’expérience de sortir de sa place habituelle et de son rôle à travers la présence artistique et toutes les formes d’expression qui en découlent.
9h30 : Photographie subjective de projets créateurs de liens (lien du doc des œuvres)
Philippe Kauffmann, coordinateur artistique de Mars, nous présente une multitude de projets artistiques en les différenciant avec le critère de durabilité dans le temps. D’abord de temps court, ou une société éphémère créent un lien temporaire avec la création d’une œuvre telle qu’un parcours de domino géant traversant une ville. Ensuite de temps plus ou moins long, l’œuvre étant courte sur la durée, mais potentiellement créatrice de lien durable tel que « les promenades blanches » ou deux inconnus se retrouvent en binôme pour visiter la ville, l’un étant aveuglé par des lunettes adaptées et l’autre devenant guide. Le dernier type, de temps long, est les projets idéaux à la création de liens sociaux durables. Ce type de projets rendent les citoyennes complices de l’artiste et se perpétue dans le temps presque comme traditionnellement en créant des communautés « éternelles ». Par exemple, « La brûlée des idées noires » au festival Carolo.
10h : Libérer la parole habitante
Premier récit d’expérience de la journée donné par David Picard, directeur artistique des Passeurs et codirecteur du collectif Random. Il nous parle de l’histoire émouvante des habitants de la barre d’immeuble Robespierre qui a été démolie en 2019. Le collectif Random les accompagne dans cette période de transition à travers divers projets artistiques. Leur équipe arrive sur les lieux en 2017 sans but précis. Le collectif va habiter dans la barre d’immeubles. Selon Mr Picard, il est impossible de faire transparaître la réalité sans vivre ce que les habitants vivent et sans assurer de permanence pour faire partie intégrante de tous les moments de vie. Plusieurs créations vont se former, une représentation théâtrale conviviale où les habitants vont se voir représentés à travers différents acteurs, un slam organisé avec les jeunes et tant d’autres. Le collectif va nous parler d’un ancien habitant qui raconte qu’il ne se sent pas légitime à venir voir de l’art, mais qu’après avoir quand même assisté à la pièce de théâtre, il vécut comme un changement. Il explique qu’en regardant la pièce il a ressenti de l’émotion et alors qu’il avait tendance à dire que leur histoire n’était qu’un fait banal il finit par énoncer “ce n’est quand même pas rien ce qu’on a vécu”. À travers des dessins dans la cour de récré ou les interrogations faites aux bailleurs par des enfants, une communauté se crée grâce à l’art. Le projet se termine par une journée de synthèse, d’au revoir, de célébration, la communauté se retrouve ensemble pour partager des derniers moments avant la démolition le lendemain. L’équipe Random a donc permis aux habitants de créer du lien social durable et de traverser une période difficile avec divers projets artistiques. La phrase qui pour lui résume sa pensée : « L’art impliqué dans la vie de la cité à travers ses outils peut inventer la forme issue de tous qui mêle les différents savoir-faire pour créer un récit commun dans lequel chacun trouve sa place et reconnaît la place de l’autre ».
10h30 : Les veilleurs
Joanne Leighton, chorégraphe, nous parle du projet artistique qu’elle mène à travers l’Europe depuis 2012 avec le collectif WALDEN. Dans 10 emplacements, jusqu’à présent, s’installe pendant un an une structure appelée l’objet-abri sur un point culminant de la ville. De cette structure, tous les matins et tous les soirs, en fonction du lever et coucher du soleil, un habitant veille. Pendant une heure, un volontaire se retrouve seul dans une structure en bois local, une sorte de couloir à son échelle, une fenêtre à chaque bout, 2 fois par jour, 365 jours par an. Le projet est itinérant et en association avec différents acteurs culturels, mais il respecte certains codes précis à chaque fois. Le veilleur va d’abord s’inscrire le jour qu’il souhaite. Il va ensuite suivre un atelier préparatoire d’une heure avec un artiste pour se mettre en situation. Le jour J, il serait en présence d’un accompagnateur, ancien veilleur, c’est lui qui lui ouvrira et le guidera vers l’objet abri. L’accompagnateur prend aussi une photo de chaque veilleur et de la ville au moment où il veille. Après cette heure, le veilleur est invité à écrire dans un livre de récit, tout cela fait partie de la performance. Trois événements marquent l’année du projet. L’ouverture et la cérémonie de clôture, mais aussi les soirées de partage où les veilleurs du dernier trimestre se réunissent pour une soirée de danses, de lectures et d’échanges. Johan Leighton insiste tout au long de son récit que n’importe qui peut participer et qu’elle veut que tout le monde de, quelque caractéristique qu’iel soit, y participe. Pour cela des acteurs de terrain vont aller chercher les gens qui ne participent pas instinctivement à ce genre d’événement. À la fin de l’année, un livre est remis à chacun des veilleurs comme un remerciement et une trace de leurs participations.
11h : Petite pause où les discussions s’animent déjà naturellement autour du sujet de la journée en préparation au workshop collectif de l’après-midi.
11h30 : L’expérience Cultureghem, une quête d’espace commun de qualité
Anne Watthee, chargée du développement culturel de l’ASBL Cultureghem basée au abattoirs et marché d’Anderlecht/Cureghem, vient nous parler du projet. L’ASBL tourne autour de trois axes : la nourriture, l’espace et les gens au travers de différents projets. Le vendredi et le week-end, la grande halle couverte au centre du quartier des abattoirs accueille un marché. Le reste de la semaine, l’ASBL dispose d’une surface de dix mille mètres carrés pour y faire ce qu’elle veut grâce à l’accord passé avec les abattoirs. Mme Wathee nous parle tout d’abord de CollectMet, une équipe de bénévoles qui récolte les invendus à la fin des marchés, soit environ 3,5 tonnes de nourriture chaque week-end. Cette collecte alimente toutes les ASBL qui souhaitent en bénéficier, mais surtout la Dreamkitchen. Tenue par la Dreamteam, la Dreamkitchen assure une soupe et un repas à contribution libre tous les midis de la semaine. Elle nous présente ensuite d’autres projets portés par le groupe et termine par OMTA. En toutes lettres; Open Meeting Space for Temporary Art, ce nouveau projet naît des demandes d’artistes, mais surtout des envies des bénévoles et une envie de rassembler. Après diverses expérimentations, Cultureghem définit un cadre précis pour OMTA et lance en parallèle HOW TO OMTA. L’ASBL offre alors différentes périodes où l’art peut s’installer, en crescendo au long de l’année, la haute saison étant l’été. Cultureghem choisit aussi de demander une contribution personnelle de l’artiste. Iels vont devoir cuisiner au moins une journée pour la Dreamkitchen et “teaser” leur performance pendant les collectes en fin de marché. En échange, l’ASBL offre un soutien logistique, un grand espace et une communication locale. Mme Watthee explique après qu’il n’y a pas de budget artistique, car l’ASBL n’a pas la vocation de devenir une institution, elle préfère prôner l’investissement commun.
12h : Claudio Stellato, artiste en résidence à l’université
Frédéric Blondeau, responsable service culturel de l’UCLouvain, nous amène à visionner 2 petits films sur les artistes en résidence que l’UCLouvain accueille dans le cadre d’une
minorité. Nous avons pu y voir qu’amener l’art au travers de l’expérience humaine d’artiste à étudiant, en dirigeant les étudiants vers un projet commun ou personnel au lieu de donner simplement cours magistral, mène vers un apprentissage enrichissant et très apprécié des deux cotés. Le deuxième film se penche sur cette année 2021-2022. C’est Claudio Stellato, artiste pluridisciplinaire, qui a dirigé les étudiants vers une création théâtrale loufoque, ou pour certains insensée. Nous pouvons plus y voir le point de vue des étudiants, dont l’une d’entre elles énonce un point intéressant : « On cherche toujours à comprendre, mais parfois il ne faut pas comprendre ».
12h30 Zonneklopper, une autre tentative pour faire culture et société
Melina Desse et Anna Ternon sont venues nous présenter l’ASBL qu’elles portent, Zonneklopper. Iels débutent leurs récits d’expérience par une reformulation de la problématique de la journée pour dénoncer les pratiques de certaines institutions. “Comment l’institution prétend nouer des liens avec les citoyen-ne-s en chargeant les artistes de réparer et de guérir les blessures et fractures sociales via des missions à court terme”. Selon elles, la réponse c’est l’imposition des deadlines, l’obligation de résultat et de compte rendu, la délégation du rôle social et l’absence de contrat “employé” qui crée des situations précaires pour les artistes et ne pérennise pas le lien social qui pourrait se créer à travers une œuvre. Elles avancent aussi qu’on donne souvent comme rôle à l’artiste de soulever des questions sociales alors que cette pratique institutionnelle revient à déléguer un rôle qui n’est pas de ressort artistique. Iels continuent par nous expliquer ce qu’est Zonneklopper. Basée dans un grand complexe anciennement abandonné à Forest, l’ASBL regroupe des gens et artistes ayant la volonté de se réapproprier leurs vies et combattre l’utilisation abusive de l’artiste à d’autres moyens que la production artistique. Au terme de cette lutte, le bâtiment devient le leur pendant cinq ans, « une zone à inventer ensemble » comme leur charte l’énonce. Dans ce bâtiment, on retrouve déjà des espaces de vie et de travail abordables, de rencontre, de monstration et d’accueil. Iels nous expliquent comment se passe la prise de décision avec les personnes qui y vivent/travaillent. Tout le monde se regroupe au sein de l’agora le mercredi pour soulever les points qu’iels souhaitent aborder et iels en discutent pour arriver à un accord commun. Cela est fait à l’aide parfois de « facilitateurs » , groupe plus petit assigné à certaines tâches pendant un temps. Iels avouent faire face à quelques difficultés. Par exemple de ne pas savoir investir tout l’espace aussi rapidement que voulu par manque de temps, mais iels sont heureux d’y faire face pour avancer vers ce qui leur tient à cœur.
Iels expliquent alors ce que selon iels les institutions pourraient faire pour soutenir les artistes et créer du lien social durable : mettre à disposition des logements et espaces de travail abordable ainsi que des espaces de rencontre, connaître elles-mêmes leurs territoires, être bien plus à l’écoute des besoins et désirs des citoyens et enfin employer les artistes pour travailler au sein de l’institution au lieu de leur déléguer certaines responsabilités.
13h : Pause de midi, nous nous délectons autour d’un pain grillés avec du fromage blanc, de la sauce salsa et plein de légumes différents au choix. Miam 🙂
14h : Nous nous dirigeons vers « L’espace des possibles » L’espace polyvalent de la Maison Folie, pour commencer un workshop de discussion animé par Flora Six.
L’atelier commence par la création du portrait chinois de la Maison Folie en trois groupes de 10. Le but était d’associer ensemble un animal, une célébrité, une saison, une fête, un objet et un mot à la Maison Folie. La première activité soulève ce que représente cet endroit pour les personnes autour de la table.
Ensuite, pour la deuxième, il nous a été demandé de poser le présent et le futur espéré pour la Maison Folie sur différents axes tel que « surprenant vs conventionnel ». Notre groupe n’a pas beaucoup avancé dans la liste des axes tellement les discussions sur les premiers points étaient fournies et prenantes. Tous les âges se retrouvent autour de la table avec différentes expériences citoyennes plus ou moins liées à Mons. Un citoyen nous parle de son expérience et sa déception dans la transition après 2015 où tout a selon lui été chamboulé et qu’il faut tenter de plutôt recréer les liens déjà créés à travers certains groupes culturels perdus jusqu’ici. D’autres expriment que l’institution doit être complexe au sens de sa capacité à varier et mélanger tout type de culture, mais fait simplement pour permettre à tous d’y accéder et de partager.
Enfin, nous faisons une mise en commun entre les trois groupes en nous apercevant que les discussions ont pris des approches très différentes à certaines questions, mais toutes avec le même sentiment de vouloir voir la Maison Folie devenir un lieu qui rassemble encore plus.
Au terme de cette journée il y a beacoup à apprendre.
Les présentations du matin qui alimentent les discussions de l’après-midi ont permis de soulever certaines questions portant à réflexion.
Quelques conclusions sont tirées. Les artistes font de l’art comme un cinéaste fait des films, le lien avec le social doit se faire selon la volonté citoyenne de l’artiste et non celle de l’institution qui l’emploie.
Parfois, il faut savoir laisser place à l’inconnu et faire confiance pour permettre l’expression. Sans codifier, l’institution laisse l’accès à une population plus large, à un plus grand nombre de rencontres et de créations de liens.
Les preneurs de décision devraient davantage être connaisseurs du terrain ou devraient employer plus de travailleurs sociaux permettant une meilleure écoute et adaptation aux citoyens concernés par leurs décisions.