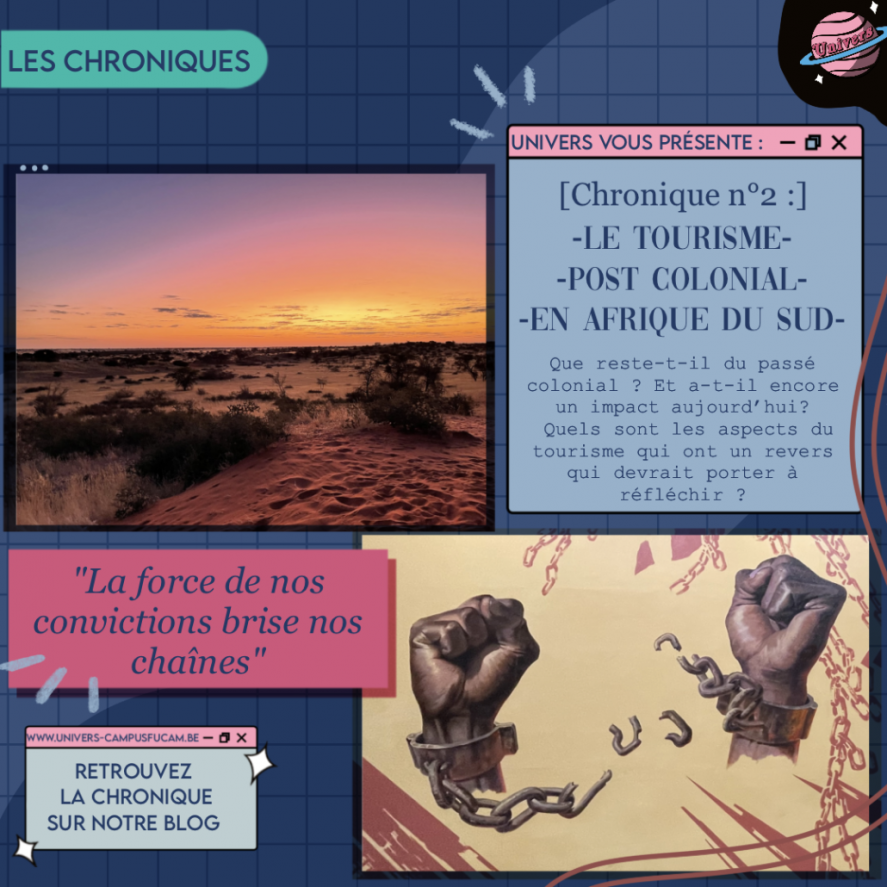
Le continent africain a connu un nombre effarant d’atrocités lors de la course à la colonisation à la fin du dix-huitième siècle. Aujourd’hui, ces pays deviennent de plus en plus des destinations touristiques prisées. Ayant eu la chance de voyager au sud de l’Afrique et ayant pu observer, certes d’un point de vue biaisé, certaines caractéristiques intrigantes du tourisme, nous nous sommes posé quelques questions. Que reste-t-il du passé colonial, a-t-il encore un impact aujourd’hui ? Dans quelle mesure les touristes qui visitent ces pays sont-ils amenés à fermer les yeux ou à les ouvrir sur ce sujet difficile ? Quels sont les aspects du tourisme qui ont un revers qui devrait porter à réfléchir ? Nous allons tenter d’y répondre, grâce à l’expérience et les rencontres faites sur place. Mais, nous devons l’avouer, majoritairement grâce à des recherches postérieures.
Commençons par un petit bout d’histoire.
Le sud de l’Afrique connaît différentes colonisation, en majorité britannique, mais aussi portugaise avec le projet de la carte rose (créer un axe est-ouest reliant les colonies de l’Angola et du Mozambique), et encore allemande dans l’anciennement appelée “Afrique du Sud-Ouest”.
Ces pays ont non seulement connu les violences de la colonisation, mais subissent également à certains endroits la guerre entre colons.
La Namibie par exemple est d’abord colonisée par les Allemands, sous les ordres du colonel Von Bismarck. Les Herero et les Nama, peuples qui vivaient alors sur le territoire sont capturés et mis aux travaux forcés. Lorsque la révolte éclate dans les années 1900, l’armée tue sans distinction ou en envoie certain•e•s dans des camps de concentration après avoir été inspecté•e•s par un médecin allemand jugeant leurs aptitudes à travailler de force.
En seulement quatre ans, respectivement quatre-vingts et cinquante pour cent du peuple Herero et Nama sont décimés. Ensuite, la double peine prend place en 1950, le peuple restant se voit imposer l’apartheid par l’Afrique du Sud sous commandement anglais. Le peuple noir est divisé dans de petites parcelles du territoire majoritairement au nord et le reste du pays est sous le contrôle des blancs. Après beaucoup de combats pour la liberté menés par l’alliance populaire SWAPO et un cessez-le-feu qui pousse les Britanniques à se retirer, la Namibie prend son indépendance très récemment en février 1990.
En allant en Namibie cette année, nous ne nous étions pas renseigné•e•s à l’avance. Nous étions curieu•ses•x de voir ce que nous allions pouvoir observer de ce passé à partir d’une feuille blanche. Et bien, il faut l’avouer, si ce n’est pour les recherches par après, cette feuille serait restée brouillonne. Mais commençons par les petites choses qui nous étaient visibles. En changeant de lieu tous les deux jours, un schéma se dessine ; tous les lieux touristiques à l’exception d’un sont détenus par des personnes blanches qui après discussion, n’étaient émigrées européennes que de 2e génération au maximum. À l’inverse, les employé•e•s, étaient en majorité noir•e•s, (assez normal pour un pays composé à 90% de personnes noir•e•s, vous nous direz). Ce qui pose le plus question c’est surtout : comment se fait-il alors que la population d’origine européenne, qui ne constitue que 6,6 % de la population totale, soit celle qui détient tout le secteur touristique ? La réponse : conséquence directe de la colonisation. Les Européen•es, enfants de colonisa•teurs•trices, se retrouvent dès la naissance en avantage économique. Malgré la fin de l’apartheid, les blanc•he•s restent en Afrique et le racisme persiste dans un pays tout de même majoritairement noir. Pour se relever économiquement de la colonisation, les populations opprimées sont encore une fois victimes de discriminations et devraient apporter nettement plus d’efforts que la population blanche privilégiée.
Au nord du pays se concentre l’exploitation agricole, qui emploie 50% de la population, mais qui est loin d’être l’industrie la plus lucrative par individu. Une nouvelle fois, c’est une conséquence de la colonisation, pendant laquelle les populations noires étaient enfermées dans les terres fertiles au nord du pays pendant que les blanc•he•s s’occupaient de l’activité économique dans la capitale Windhoek. Cette perpétuation du schéma agricole qui fut commencé pendant l’aparteid est l’une des nombreuses formes de néocolonialisme retrouvé aujourd’hui.
Encore aujourd’hui, lorsque nous demandons des conseils touristiques à Windhoek, on nous dirige vers les quartiers blancs “sécurisés” et nous dit de contourner les quartiers noirs “dangereux”. Le racisme demeure.
L’autre expansion majeure récente est l’exploitation minière. L’Asie, mais en plus particulier la Chine, commence à prendre le monopole de ces terres abondantes en métaux et pierres précieuses. Une nouvelle fois, le capital économique se trouve en main étrangère et laisse le bas salaire à la population locale. Sans protection des travailleurs et travailleuses, comme on peut la connaître en Belgique, le sud de l’Afrique se dirige vers une forme d’esclavagisme moderne comme on l’observe déjà en Chine.
L’autre chose majeure que l’on peut observer, est le manque flagrant d’information donnée aux touristes sur la colonisation. Ce qui nous a le plus étonné•e•s c’est cette manière de décrire certaines villes comme de magnifiques représentations de l’architecture allemande sans parler de pourquoi elles sont là. La seule vue que nous avons pu avoir sur tout cela était lors de la visite du musée national de Namibie sur lequel nous sommes tombé•e•s par hasard. Il comporte d’énormes fresques, sculptures et photos des combats pour l’indépendance, une visite marquante que nous recommandons. En marchant dans le musée, l’ambiance est pesante, mais un vent d’espoir se lève en lisant la phrase que nous avons particulièrement appréciée, et qui pourrait encore être d’actualité ; “les chaînes se brisent par la force de nos convictions”.
D’un point de vue global, le voyage fait ressentir chez nous peut-être un certain malaise, car c’est une forme de tourisme particulier. Là-bas pas d’hôtel, plutôt des “lodges”. Souvent, de petites huttes luxueuses et privées à la place des chambres, mais surtout un service complet pour s’assurer que le client ne fasse rien de lui-même. Nous avons rencontré une famille d’Espagnols d’origine asiatique (seuls touristes non blancs rencontrés lors du périple). Nous échangeons avec iels et un ressenti se dégage. L’impression de peut-être revivre une façon arrière des choses, ou les riches blanc•he•s se font servir par des tonnes de petites mains noires, répondant à toutes leurs demandes. Après plus de discussions nous découvrons aussi qu’iels sont végétarien•ne•s, et tout comme pour le service nous nous rendons compte ensemble que la façon de manger excessive avec de grandes pièces de viande émane aussi d’une certaine manière abusive de manger qui commence à changer chez nous, mais qui persiste sur la scène touristique, comme si pour le temps des vacances tout s’oubliait. Par ailleurs, cette viande qui est appelée “game meat” porte selon nous bien son nom. Gibier de traduction directe, “game” se traduit aussi en “jeu”, ironiquement cela traduit bien la situation un peu déconcertante de faire des safaris le jour et voir des troupeaux de zèbres dans des réserves (parfois artificielles), mais ensuite d’en manger en steak le soir (surement élevé dans des conditions bien différentes). Tout cela nous amène à conclure que la colonisation fut dévastatrice dans le passé, c’est certain, mais que de surcroit une forme de néocolonialisme est bien présente et qu’elle induit encore certains comportements inégalitaires et injustes.
Ne vous détrompez pas, le tableau n’est pas unicolore et sombre. Ces pays sont remplis de paysages, de faune et de flore incroyables et bouleversants. Cet article cherche simplement à conscientiser sur les aspects parfois cachés aux touristes, mais surtout vise à ouvrir les yeux sur le changement qu’il reste à mener dans ces pays et dans notre monde en général. Enfin, d’amener de la lumière sur ce double standard de lutte dans nos pays tout en fermant les yeux sur le reste du monde alors que notre société est de plus en plus mondiale.
✍️ : Victoria Wilms
🎨 : Siilen Dig
📸 : Victoria Wilms (Photo prise au musée national de Namibie)

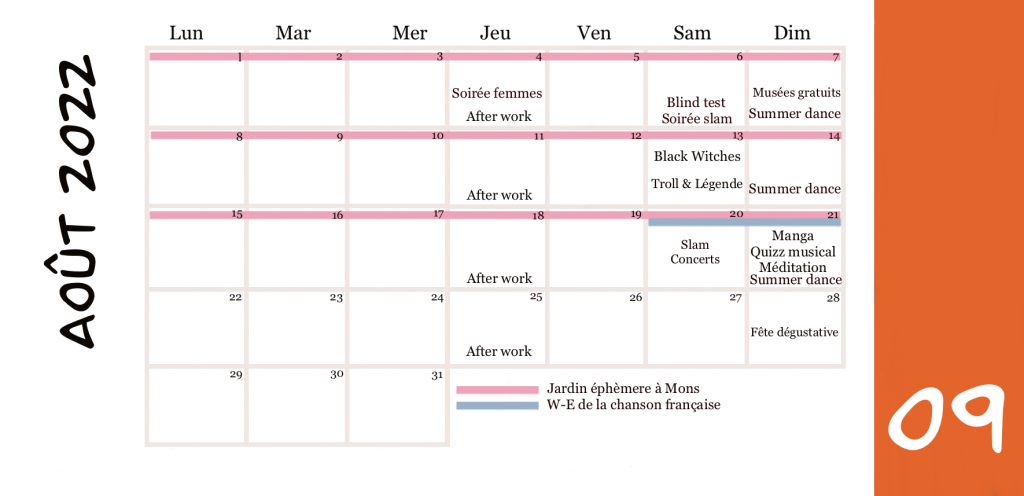
Merci pour cet article aussi excellent qu édifiant !!!!!